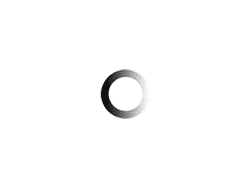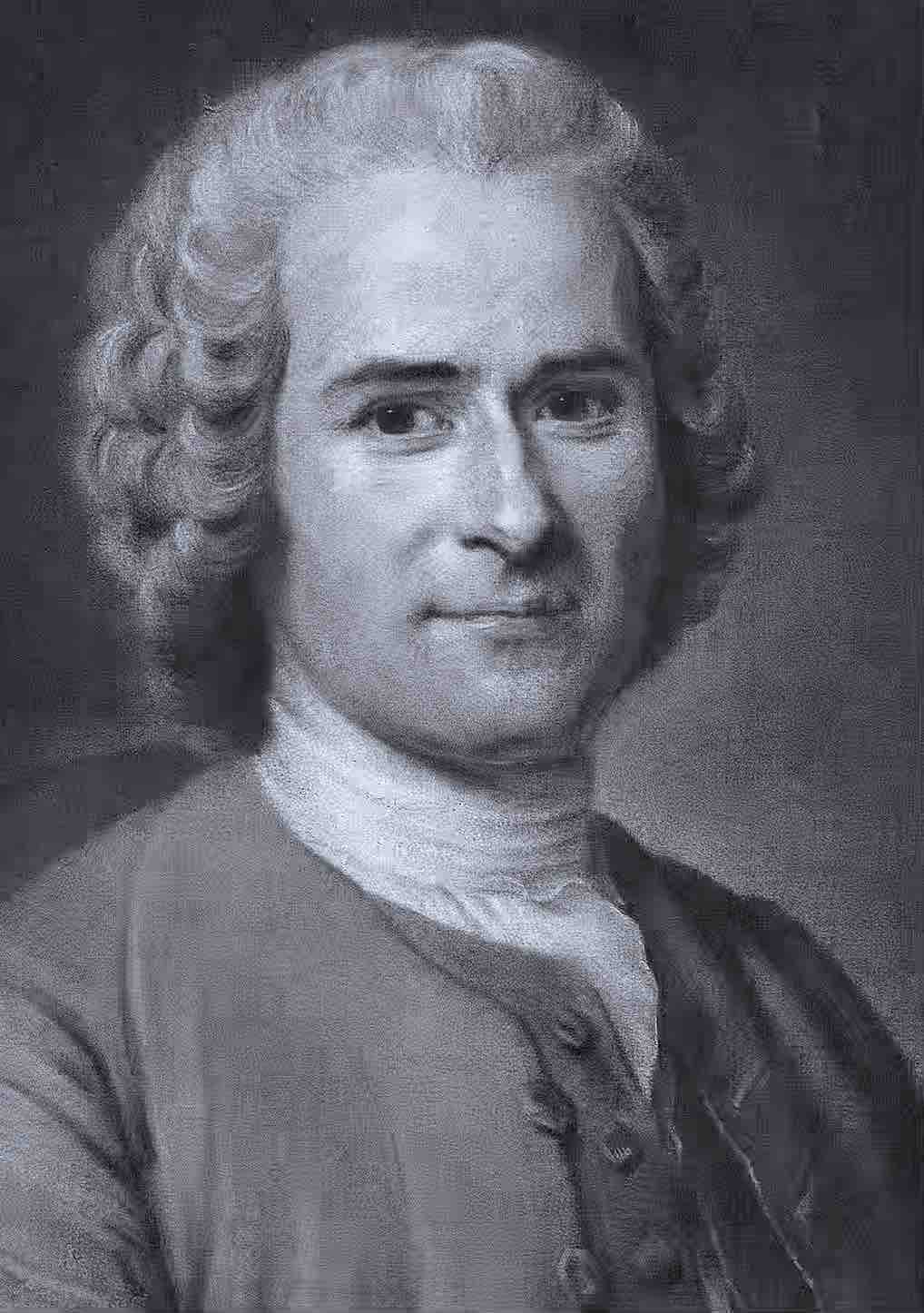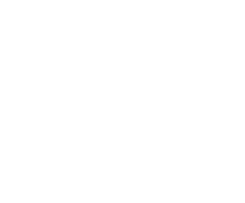« Je crois qu’il faut arriver par discipline à n’avoir que des tentations nobles. Et à ce moment là il est urgent de succomber… même si c’est dangereux ; même si c’est impossible ; surtout si c’est impossible. » Jacques Brel, Interview filmée, infra (à 7’10).
Si je ne me souviens pas quand j’ai écouté Jacques Brel la première fois, je sais quelle était la dernière fois. Quelle que soit la saison, l’année, le moment, le jour, je sais que la dernière fois que j’ai écouté Jacques Brel est aujourd’hui ou hier. Voilà ma drogue, voilà, avec la San Pellegrino, la seule substance que j’absorbe absolument tous les jours ! Jamais de renoncement pour mon eau à bulles puisque j’irais jusqu’à traverser l’Italie pour aller voir le « château » dessiné sur chaque bouteille que j’ai bue ; jamais de renoncement pour un Amsterdam, une Quête, un Prochain amour ou un Orly.
Brel ne m’a jamais abandonné. Depuis une trentaine d’années, je l’écoute 2 à 3 fois par jour. C’est un besoin ; il calme mes angoisses ; il me parle de l’amour, il me parle de la mort, de la tendresse de nos rêves. Il éclaire mes amours, m’invite à danser et toujours me fait vibrer.
Lorsque Bob Dylan a reçu le Prix Nobel de Littérature, j’étais heureux. Enfin, l’élite internationale avait compris que la musique n’est pas un agrément facétieux ; la musique est essentielle à notre existence. Je me demande d’ailleurs comment nos ancêtres ont pu vivre sans musique. Comment passer une journée sans écouter quelques morceaux de nos stimulateurs hormonaux ? La musique me nourrit ; elle m’est aussi naturelle que le sommeil qui ponctue mes journées.
D’aucuns imagineront que j’exagère. Que nenni ; au réveil, dans ma salle de bain, dans ma voiture, avec mes écouteurs, doucement, forte ou terrassante, la musique est ma véritable drogue !
En 1993, j’ai décollé pour l’archipel du Svalbard, autrement appelé Pôle Nord. Un concours organisé par la fondation de Nicolas Hulot ; je gagne avec 9 autres jeunes gens et m’envole sans musique pendant 3 semaines. Alors qu’à l’époque mon walkman pesait 1 kg, alors que le rembobinage des cassettes se faisait autour d’un crayon de papier, je ne vivais pas sans mon walkman.
Au bout de 3 semaines sans musique, le manque était manifeste. J’étais plus que frustré, j’étais torturé. Avec un jeune ami en manque comme moi, nous parlions de musique, de sensation, de chair de poule, de Debussy, de Brel évidemment, dont le bougre ignorait l’existence ! En kayakant entre les icebergs, en marchant sur des terres brûlées par des dragons de vents à -30°, nous parlions musique ; irritant nos compagnons d’infortune.
Le manque était violent, 3 semaines de marches, de froid pour voir le rien, la nature sans nature, des terres sans végétation, et vivre les uns sur les autres alors que nous étions seuls au monde. Que Rousseau a raison…
Lorsqu’au retour, nous fûmes bloqués pour cause de tempête à Tromsø ville septentrionale de Norvège, je n’y tins plus, je voulus écouter de la musique. N’importe quoi mais de la musique. Peu m’importait ; comme un drogué, le manque de musique me rendrait agressif. J’avais trop mal du manque de musique.
Mais la ville était déserte, rien n’était ouvert et le seul « pub » du coin rangeait ses chaises dans un silence métaphysique de film soviétique.
La mort dans l’âme je retournais à l’hôtel pour dormir enfin au chaud éloigné des tempêtes de ces dragons de vents qui traversent notre peau pour planter leurs griffes acérées au cœur même de notre chair contre nos os d’adolescents mal foutus.
Je rentre alors dans ma chambre et l’observe avec un rituel qui ne m’a jamais abandonné : debout dans l’entrée, je me projette dans mon lit et imagine toutes les sources de lumières pernicieuses qui viendront perturber mon trop léger sommeil, puis j’identifie salle de bain, mini-bar, source lumineuses électriques que j’aurais oubliées et l’ensemble des objets inutiles ; très fréquents à l’époque.
Puis la déco y passe, critique en règle du degré de cohérence kitsch recherchée par le designer. A Tromsø, il n’y avait probablement jamais eu de designer ou architecte. Le kitsch était naturel. Tout était marron et empêtré de formes et textures archaïques, c’est-à-dire des années 60 puisque j’établis, au risque d’un égocentrisme naïf, l’archaïsme esthétique à tout événement antérieur à l’année 1975, année de ma naissance.
Bref, du marron, du jaune, et une tapisserie chevronnée au goût certain pour le désagrément des yeux, tout me semblait irrespirable. Mais, car il faut un mais, je remarque planté dans le mur un commutateur métallique rond. Mon cœur tressaille, il s’emballe, non ce serait trop beau, là comme au temps jadis, un « bouton » pour allumer… une radio.
Mon cœur bat réellement la chamade ; je me jette sur le mur, je caresse autour du commutateur, je l’effleure ; il est là. Mais s’il ne fonctionnait pas. Je prends mon temps. Je sais depuis longtemps que le meilleur moment d’un événement le précède inexorablement. Je suis surexcité, j’ai envie d’appeler mon camarade. Je sais qu’il le verra aussi. Mais quel type de musique passe-t-on à Tromsø ?
D’un coup, je crains le pire. Une émission radio avec de vieilles personnes qui parlent de très vieilles personnes à de plus vieilles personnes pour les endormir dans un norvégien guttural dont la mélodie m’échappe. J’ai les mains moites. Tant pis, il faut voir…
Je tourne le commutateur en laiton… rien ne se passe… J’attends ; pas un son ; pas un mot. Je suis déçu, je fixe le commutateur tristement…
Mais je distingue, je reconnais, j’exulte, non impossible, c’est pas vrai, le son monte, je l’aide et tourne le bouton, mais non ! J’entends, mais oui j’entends Jacques Brel qui entame Amsterdam, à l’Olympia (1964) !
Je suis immobile les yeux accrochés au laiton ; mon cœur s’arrête brutalement, des larmes m’envahissent, c’est tellement beau, j’ai l’impression de naître, la musique me brûle les poumons. Brel est avec moi, il me ramène au monde des sentiments, l’enfer des glaces disparaît, je suis vivant, enfin vivant.